- SOCIAL-DÉMOCRATIE
- SOCIAL-DÉMOCRATIELa social-démocratie, en tant que mouvement et idéologie, est un produit du XIXe siècle, une conséquence du processus d’industrialisation qu’a connu l’Europe. C’est en 1889 que le mouvement international de la social-démocratie, expression politique de la défense de la classe ouvrière contre l’exploitation capitaliste, se donne un cadre organique par la création à Paris de la IIe Internationale, elle-même héritière de l’Association internationale des travailleurs (ou Ire Internationale, fondée à Londres en 1864), grandement inspirée par Karl Marx. La fondation de cette organisation est précédée pendant des dizaines d’années par des luttes sévères du prolétariat naissant contre des conditions de travail inhumaines, notamment contre le travail des enfants.En Angleterre, berceau du monde industriel, des caristes s’en prennent aux machines, avant que les trade-unions ne parviennent à prendre pied dans les usines. En France, la lutte des canuts, au début du XIXe siècle, préfigure le syndicalisme révolutionnaire, idée et forme d’organisation qui resteront longtemps vivantes dans le mouvement ouvrier, avant qu’un mouvement d’inspiration social-démocrate ne réussisse à s’insérer dans le jeu social. En Allemagne, enfin, où le féodalisme conserve sa domination politique malgré l’extraordinaire essor de l’industrie, le prolétariat a de la peine à constituer ses associations de défense contre une exploitation qui n’est pas moins révoltante qu’en Angleterre. En témoigne la révolte des tisserands de 1844, réprimée avec une violence inouïe. Mais, vingt années plus tard, se constituent les premières associations ouvrières nourries par la pensée social-démocrate.1. Le processus d’unificationVers la fin du XIXe siècle, la IIe Internationale, loin d’être un ensemble homogène, réunit en son sein des partis européens qui, au prix de luttes sévères entre groupes d’inspiration marxiste, libertaire ou syndicaliste, ont petit à petit réussi à se forger une idéologie commune, dominée par la pensée socialiste.Premiers regroupementsDans le Parti social-démocrate allemand, guidé par August Bebel et Wilhelm Liebknecht, c’est incontestablement le marxisme qui inspire la réflexion et l’action: surtout depuis 1891, où le congrès d’Erfurt réussit à surmonter les «déviations» de Ferdinand Lasalle, qui, malgré la volonté de Marx et d’Engels, avait essayé d’engager le mouvement naissant des travailleurs dans une alliance avec la monarchie et Bismarck contre la bourgeoisie «scélérate». En Italie, où, au début, les groupements libertaires avaient dominé le mouvement ouvrier naissant, s’impose, finalement, une tendance socialiste influencée par le marxisme: d’abord, et déjà assez nettement, au congrès de Gênes en 1862, puis, de manière bien plus décisive, à celui de Rome en 1906. En France, on assiste à une lutte intérieure semblable : la bataille est dure, à l’intérieur du mouvement ouvrier, entre ceux qui entendent imposer les idées et les formes d’action du syndicalisme révolutionnaire et leurs adversaires réformistes, qui se situent dans la mouvance soit de la pensée inspirée par Marx, soit d’un socialisme humaniste aux contours mal définis. Cette lutte idéologique est compliquée par le fait que toutes ces tendances se réfèrent, en leur donnant une interprétation fort différente, aux révolutions qui ont marqué l’histoire des XVIIIe et XIXe siècles. Mais on peut dire que la fin du XIXe siècle est caractérisée, à l’intérieur du mouvement français, par une prépondérance de l’aile marxiste, encore que les tendances syndicalistes et humanistes conservent une forte influence.L’évolution est sensiblement différente en Angleterre, où, au début, le mouvement ouvrier – avant même que Marx ne fasse sentir son emprise – est caractérisé par une forte poussée du mouvement syndical dont le thème essentiel est la conclusion de conventions collectives, mesure immédiate contre l’exploitation sauvage et sans frein dans les usines. La «philosophie» de ce mouvement, développée dans les écrits de Sydney et Beatrix Webb, a toujours prévalu contre le socialisme d’inspiration marxienne. Mais la finalité du socialisme est, malgré tout, admise en 1905 par le Labour Representation Committee, précurseur du Labour Party.Prépondérance allemandeEn résumant à l’extrême, on est en droit de dire que pendant un demi-siècle – de 1850 à 1900 – le mouvement ouvrier européen, dans les pays les plus industrialisés du Continent, se réclame de l’idée de la démocratie sociale et d’une certaine idée du socialisme telle quelle s’exprime dans le Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, car cette idée correspond à la situation vécue du prolétariat naissant. Il faut pourtant constater que la notion de «social-démocratie» avait trouvé son expression la plus achevée en Allemagne. En premier lieu, bien entendu, parce que Marx et Engels, créateurs du «socialisme scientifique», y ont exercé une influence directe et reçu des appuis essentiels: des hommes tels que Karl Kautsky, le porte-parole et théoricien vulgarisateur des idées marxiennes pendant des dizaines d’années, et Franz Mehring, biographe de la social-démocratie allemande, ont largement contribué à la diffusion, en Allemagne et ailleurs (par exemple, en Russie), de l’idée d’un mouvement de masse social-démocrate, expression des «intérêts de classe» des travailleurs.Leurs idées trouvaient d’autant plus d’audience que la social-démocratie était, en fait, considérée comme un «modèle» par les socialistes étrangers, y compris par Lénine: nulle part ailleurs, en effet, l’idée du Zukunftsstaat , de l’«État de l’avenir» fondé sur la prise en charge par les travailleurs des moyens de production et d’échange, n’avait trouvé un écho aussi retentissant. Avec une extraordinaire puissance, le mouvement fait tache d’huile. C’est en Allemagne, bien plus fortement que partout ailleurs, que l’organisation social-démocrate, préconisant la société sans classes et le socialisme, est en droit de parler au nom de la classe ouvrière; en effet, celle-ci fait bloc pour s’opposer, à la fois sur le plan politique et syndical, à un monde hostile qui entend lui contester ses droits dans les domaines politique et social.En Allemagne également sont évoqués au XIXe siècle tous les grands problèmes qui, plus tard, aboutirent au déchirement et à la scission du mouvement social-démocrate. Une lutte farouche y oppose le théoricien du « révisionnisme », Edouard Bernstein, à Karl Kautsky et à Rosa Luxemburg qui, adversaires de l’«intégration» du mouvement ouvrier dans la société capitaliste, préconisent une lutte impitoyable contre celle-ci et défendent la pureté de la pensée marxienne contre les tentations «réformistes» nées surtout dans le milieu syndical où l’on réclame une attitude «réaliste», commandée par la possibilité d’obtenir immédiatement la réalisation de réformes sociales que les «utopistes» projettent dans un avenir lointain (cf. RÉFORMISME et RÉVISIONNISME).2. Vers la scission du mouvementEntre la réforme et la révolutionDepuis ses débuts, pratiquement, le mouvement social-démocrate, et pas seulement en Allemagne, était marqué par cette lutte entre les deux conceptions du devenir social: fallait-il miser, comme le préconisaient les représentants de l’aile marxiste, sur le renversement des institutions politiques et sociales du système capitaliste ou bien fallait-il envisager la «longue marche à travers les institutions», comme le déclaraient les représentants de la social-démocratie allemande, imposer, pas à pas, par la lutte et des négociations délicates, des conquêtes sociales et politiques en faveur de la classe ouvrière?Dans les pays scandinaves, et en particulier en Suède, le mouvement social-démocrate avait opté, depuis longtemps, et pratiquement depuis sa naissance, pour le second terme de l’alternative. On a assisté, dans ces pays, à une extension considérable des partis sociaux-démocrates, ainsi que des mouvements syndicaux et coopératifs inspirés par eux. L’idée maîtresse, et qui ne semble rencontrer que peu d’opposition, est celle-ci: dans les pays où l’idée de la démocratie politique est communément acceptée, un renversement par la force des institutions politiques et sociales ne s’impose pas; ce qui peut et doit être obtenu, c’est l’élargissement des droits conquis en matière politique au domaine social, c’est-à-dire la «démocratie sociale».Dans les années soixante-dix, une telle conception a acquis droit de cité dans presque tous les partis sociaux-démocrates. Les débats autour du «révisionnisme», menés avant 1914 en Allemagne, en France et en Italie essentiellement, avaient déjà préfiguré cette évolution.La Première Guerre mondiale et, à sa suite, la révolution d’Octobre en Russie avaient abouti à une scission de la social-démocratie dans de nombreux pays, et à la fondation de partis communistes qui stigmatisaient la «trahison» des leaders sociaux-démocrates, car ceux-ci avaient accepté la guerre, abandonné l’internationalisme et opté pour le concept de l’«intérêt national».La rupturePour Lénine et Trotski, pour les internationalistes militant au sein des partis sociaux-démocrates, l’attitude nationaliste est la preuve de la déchéance définitive de la social-démocratie, la conséquence logique de son détour du marxisme révolutionnaire: selon eux, le révisionnisme, jadis préconisé par Bernstein – et combattu avec acharnement par la révolutionnaire Rosa Luxemburg avant même que Lénine ne s’aperçoive de la profondeur du phénomène –, a définitivement écarté la social-démocratie internationale du chemin qui mène au socialisme.En mars 1919, Lénine fonde au Kremlin la IIIe Internationale, sous le nom de Komintern. C’est la rupture. Au lendemain de la Première Guerre mondiale naissent partout des partis communistes, essentiellement formés par l’aile gauche des mouvements sociaux-démocrates. En France, cette scission s’opère en décembre 1920, au congrès de Tours. En Allemagne, ce sont Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht qui, en décembre 1918, se chargent de la fondation du Parti communiste.Toutefois, le mouvement social-démocrate conserve partout de fortes positions: son réformisme attire de nombreux travailleurs. Par ailleurs, les programmes de différents partis sociaux-démocrates gardent une «tonalité» socialiste: ainsi, aux lendemains de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, les sociaux-démocrates allemands et français, ceux-ci rassemblés à l’intérieur de la Section française de l’Internationale ouvrière (S.F.I.O.), continuent-ils à se réclamer de la collectivisation, de l’appropriation collective des moyens de production et d’échange, tout en mettant en œuvre une politique qui ne semble pas être en concordance avec les buts proclamés.La pratique constante des différents partis sociaux-démocrates depuis la fin de la Première Guerre mondiale autorise l’appréciation suivante: il s’agit d’organisations dont le but essentiel est d’aboutir, à travers un processus plus ou moins long, à une amélioration constante du niveau de vie des travailleurs. Ces partis récusent la violence comme moyen pour parvenir à leurs fins; ils sont, en effet, convaincus de la conscience réformiste des classes laborieuses et considèrent que la société industrielle moderne offre suffisamment de possibilités de promotion sociale pour que, dans une démocratie politique, «conquête de la classe ouvrière», on n’ait pas recours à des moyens violents. Dans ce même cadre, différents partis sociaux-démocrates envisagent, parfois, la nationalisation de certaines branches d’industrie pour briser, si nécessaire, la résistance des industriels mus par des intérêts partisans opposés à l’intérêt général.C’est là une vision essentiellement réformiste et optimiste du monde comme de son évolution et dont l’influence, prévalant finalement, n’a jamais cessé à l’intérieur du mouvement social-démocrate. En ce sens, l’exemple type de la social-démocratie allemande se manifeste de façon linéaire, depuis le révisionnisme de Bernstein et la pratique «opportuniste» des syndicats liés au Sozialdemokratische Partei Deutschlands (S.P.D.) jusqu’au désir constamment exprimé d’être «intégré» dans les structures de la société actuelle.3. Un nouveau «modèle»La volonté d’intégration sociale, le désir d’être «accepté», a eu comme conséquence une évolution de la pensée de certains partis sociaux-démocrates. Un nouveau «modèle» est né, conçu par la même social-démocratie allemande qui, dans le passé, avait si souvent joué le rôle de guide de la communauté internationale de la social-démocratie.En 1959, le S.P.D., réuni en congrès à Bad Godesberg, révise tous ses programmes antérieurs pour en extirper tout ce qui pourrait rappeler la vision classique du socialisme. À ce moment, il s’agit de préparer l’organisation aux futures responsabilités gouvernementales et de lui attirer la faveur des classes moyennes profondément hostiles à la pensée socialiste, même sous la forme réformiste.Le programme de Bad Godesberg proclame, à cet effet, que «le Parti social-démocrate est devenu, d’un parti de la classe ouvrière, celui du peuple». Brisant totalement tout lien avec le socialisme classique et même avec le révisionnisme qui était resté dans la mouvance socialiste, le nouveau programme déclare sans ambages que: «La concurrence libre et la libre initiative des entrepreneurs sont des éléments importants de la politique économique social-démocrate.» Est de même souligné que le Parti social-démocrate «approuve le marché libre, là où il y a réellement concurrence», et le nouveau modèle proclame: «La propriété privée des moyens de production a le droit d’être protégée et encouragée dans la mesure où elle n’empêche pas la création d’un ordre social juste.» Il est vrai qu’un tel programme se réfère au «socialisme démocratique qui, en Europe, est enraciné dans l’éthique chrétienne, dans l’humanisme et dans la philosophie classique».L’importance de ce nouveau programme apparaît nettement: c’est la rupture la plus radicale avec l’acquis théorique de plus d’un siècle. Rupture significative dans la mesure où les sociaux-démocrates autrichiens, jadis adeptes de l’«austro-marxisme» radical d’Otto Bauer, ont emboîté le pas à leurs camarades allemands, suivis par la social-démocratie suisse.Faut-il désormais faire la distinction entre «sociaux-démocrates» et «socialistes»? Sans doute, dans la mesure où, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, les organisations de jeunesse de la social-démocratie, récusant parfois violemment ce nouveau modèle, continuent à mettre en cause les structures capitalistes de la société et réclament des «réformes de structures» qui, selon leur volonté, devraient aboutir à surmonter le «néo-capitalisme». Il faut ajouter que si ce modèle présenté par les sociaux-démocrates allemands ne suscite guère l’hostilité des partis sociaux-démocrates dans les pays scandinaves, essentiellement pragmatiques, il n’est absolument pas compatible avec les options collectivistes des socialistes français et italiens, mais semble correspondre, en revanche, à la vision des sociaux-démocrates italiens. Il est à prévoir, d’ailleurs, que d’autres partis sociaux-démocrates suivront, à court ou à moyen terme, l’exemple donné par la social-démocratie allemande.La «pratique» correspond d’ailleurs aux principes énoncés: dans les pays scandinaves, véritable bastion du réformisme, la social-démocratie prend quelquefois ouvertement position contre l’«utopie socialiste», ainsi que contre toute idée de planification économique, emprunte ses idées à Keynes et admet, tout au plus, une intervention temporaire de l’État dans les affaires économiques, afin de «corriger» les excès les plus évidents du libéralisme. Sa conception générale est d’assurer, grâce à une politique fiscale progressive, une part plus grande du revenu national aux classes laborieuses et d’accélérer, grâce surtout à la «promotion municipale», la participation la plus large de la population aux affaires publiques.Ce nouveau modèle est un concept démocratique, mais qui ne se distingue que par les nuances des dispositions défendues par certains courants libéraux. Le pragmatisme l’emporte dans tous les domaines, et la vision d’une société future, l’«utopie créatrice», propagée par quelques socialistes, est abandonnée. La tendance vers l’«intégration» dans la société actuelle est encore plus forte dans les rangs de la social-démocratie allemande. Le système de la cogestion dans la sidérurgie et dans les charbonnages, inspiré et mis en pratique par le S.P.D. et le D.G.B. (Deutscher Gewerkschaftsbund), la Confédération syndicale allemande, répond, certes, au désir de s’opposer à la toute-puissance du patronat, mais il repose, finalement, sur l’idée que les rapports actuels entre les partenaires sociaux, fondés sur la propriété privée des moyens de production, sont immuables.La social-démocratie demeure cependant dans de nombreux pays, et surtout en Europe occidentale, l’organisation dans laquelle se reconnaissent des millions d’hommes opposés au conservatisme et qui aspirent à la création d’une société plus juste et plus humaine.En d’autres termes: la social-démocratie reste, malgré son détour de l’utopie, un facteur essentiel du mouvement ouvrier contemporain. Mais d’ores et déjà ses leaders se heurtent à la jeune génération universitaire et ouvrière qui, elle, aspire à une transformation radicale de la société. Il est donc facile de prévoir des crises qui, très probablement, secoueront sévèrement la social-démocratie. Ces crises, on les constate, par exemple, aux Pays-Bas où le courant de la social-démocratie «classique», qui reste attaché aux notions socialistes, a conquis la majorité du parti, ce qui a amené la minorité, attirée, elle, par le nouveau modèle du S.P.D., à se constituer en organisation autonome. On retrouve le même phénomène en Allemagne où un courant relativement fort, représenté surtout par la jeunesse, attaque sans relâche la «liquidation du socialisme» entreprise par la direction du S.P.D. Des mouvements semblables peuvent s’observer au Danemark, en Finlande et en Suisse. Dans tous ces pays, la social-démocratie est confrontée à une véritable crise idéologique.L’enjeu est considérable et peut être formulé de la manière suivante: est-ce que, face au néo-capitalisme, les théories socialistes, adaptées aux conditions du monde moderne, conservent leur valeur ou faut-il, comme l’affirment les sociaux-démocrates allemands, s’adapter au monde tel qu’il est, quitte à l’humaniser?
social-démocratie [ sɔsjaldemɔkrasi ] n. f.• 1899; de social-démocrate♦ Polit. Socialisme allemand, de tendance réformiste. — Par ext. Socialisme réformiste. Les social-démocraties scandinaves.
● social-démocratie, social-démocraties nom féminin Courant d'idées issues du marxisme et auquel se référaient les partis politiques de langue allemande et les pays scandinaves au sein de la IIe Internationale. Ensemble des organisations et des personnalités politiques qui se rattachent au socialisme parlementaire et réformiste.social-démocratien. f. POLIT Dans certains pays (Allemagne et pays scandinaves, notamment), doctrine des socialistes appartenant à l'Internationale socialiste. Les social-démocraties.⇒SOCIAL-DÉMOCRATIE, subst. fém.POLITIQUEA. — Courant socialiste révolutionnaire marxiste principalement implanté en Allemagne, en Russie et dans les pays scandinaves durant la deuxième moitié du XIXe s. et jusqu'aux environs de la Révolution d'Octobre 1917; p. méton., ensemble des personnes et des organisations politiques qui composent ce courant. C'est le respect superstitieux voué par la social-démocratie à la scolastique de ses doctrines qui a rendu stériles tous les efforts tentés en Allemagne en vue de perfectionner le marxisme (SOREL, Réflex. violence, 1908, p. 188). « Le vote des socialistes français, à la Chambre, c'est déjà un coup terrible » (...). « On s'y attendait un peu, malgré tout, depuis l'assassinat de Jaurès... Mais les Allemands! Notre social-démocratie, la grande force prolétarienne d'Europe! (...) » (MARTIN DU G., Thib., Été 14, 1936, p. 704).B. — Ensemble de courants et d'organisations socialistes de tendance réformiste principalement implantés en Allemagne et dans les pays scandinaves. Socialisme du quotidien, soucieux d'améliorer de façon pragmatique la vie du citoyen (...) la stratégie politique de la social-démocratie suédoise a-t-elle rempli ces conditions, malgré son refus obstiné d'établir un contrôle public sur l'appareil industriel? (Le Nouvel Observateur, 27 sept. 1976, p. 44, col. 3).Prononc. et Orth.:[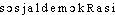 ]. V. social. Étymol. et Hist. 1899-1900 (A. COHEN, trad.: Ed. BERNSTEIN, Socialisme théorique et socialdémocratie pratique ds QUEM. DDL t. 7). Empr. à l'all. Sozial-demokratie. Fréq. abs. littér.:18. Bbg. QUEM. DDL t. 3, 10, 12.social-démocratie [sɔsjaldemɔkʀasi] n. f.❖♦ Polit. Socialisme allemand, de tendance réformiste. — On a écrit aussi sociale-démocratie. || « Aujourd'hui, on est pour ou contre le centre; pour ou contre la sociale-démocratie; on est surtout pour l'autonomie de l'Alsace-Lorraine » (l'Illustration, 2 févr. 1907).♦ Par ext. (dans le langage des révolutionnaires). Socialisme réformiste. ⇒ Réformiste.0 En « nationalisant » la classe ouvrière du centre, en lui inculquant la notion des lois « naturelles » de l'économie qui, comme par la force des choses, impliqueraient la surexploitation du travailleur noir, brun ou jaune, la social-démocratie européenne, américaine, japonaise assure à l'impérialisme son âge d'or et accepte, dans les pays du Tiers Monde, le maintien de la domination la plus meurtrière que l'humanité ait connue.Jean Ziegler, Main basse sur l'Afrique, p. 50.
]. V. social. Étymol. et Hist. 1899-1900 (A. COHEN, trad.: Ed. BERNSTEIN, Socialisme théorique et socialdémocratie pratique ds QUEM. DDL t. 7). Empr. à l'all. Sozial-demokratie. Fréq. abs. littér.:18. Bbg. QUEM. DDL t. 3, 10, 12.social-démocratie [sɔsjaldemɔkʀasi] n. f.❖♦ Polit. Socialisme allemand, de tendance réformiste. — On a écrit aussi sociale-démocratie. || « Aujourd'hui, on est pour ou contre le centre; pour ou contre la sociale-démocratie; on est surtout pour l'autonomie de l'Alsace-Lorraine » (l'Illustration, 2 févr. 1907).♦ Par ext. (dans le langage des révolutionnaires). Socialisme réformiste. ⇒ Réformiste.0 En « nationalisant » la classe ouvrière du centre, en lui inculquant la notion des lois « naturelles » de l'économie qui, comme par la force des choses, impliqueraient la surexploitation du travailleur noir, brun ou jaune, la social-démocratie européenne, américaine, japonaise assure à l'impérialisme son âge d'or et accepte, dans les pays du Tiers Monde, le maintien de la domination la plus meurtrière que l'humanité ait connue.Jean Ziegler, Main basse sur l'Afrique, p. 50.
Encyclopédie Universelle. 2012.
